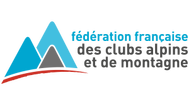Alpinisme, portraits, les grandes dates
PORTRAITS

Pour un portrait détaillé des figures de l'alpinisme cliquez sur le lien.
http://www.alpinisme.com/BD/portraits/index.php?url=somm.php
LES GRANDES DATES
Avant le 17 ème siècle la haute montagne est considérée comme maudite, c'était un sacrilège d'y accéder. Pourtant l'ascension des montagnes a été depuis longtemps pratiquée par les habitants et en particulier par les chasseurs de chamois, les cristalliers et les bergers.
Découverte par les savants et topographes militaires
Fin XIXe siècle, naissance des premiers clubs
Des bourgeois et aristocrates créent les premiers clubs alpins entre 1857 et 1874, d'abord en Angleterre, puis en Suisse, en Italie, en Allemagne, en Autriche, en Pologne et enfin en France en 1874 (club alpin français). Ces clubs définissent des usages en matière d'excursion, organisent les compagnies des guides, construisent des refuges, améliorent la qualité des hébergements, rédigent des notices scientifiquent, inventent la littérature de voyage et réussissent ainsi à promouvoir, auprès de leurs contemporains, une forme de tourisme alpin à la fois cultivé et mondain.
Le Club Alpin Français
L'acte fondateur date du 2 avril 1874 à Paris. Les 137 membres fondateurs approuvèrent les statuts et élirent 12 directeurs. Le premier Président Ernest de Billy ayant trouvé la mort deux jours plus tard dans un accident ferroviaire, Ernest Cézanne lui succéda. Le CAF connut un essor rapide, au bout de 1 an il comptait 1700 membres, répartis en 11 sections.
Dans sa préface aux statuts, E. Cézanne a écrit:
« Faire connaître la montagne, arracher les jeunes à l’énervante oisiveté des villes, aménager la montagne y entraîner la jeunesse et, par de saines émotions, l’éduquer, l’initier au culte du beau et de la liberté, à l’amour du sacré, du sol natal et de ses merveilles »
L'alpinisme acrobatique
Les alpinistes ne s'attaquent plus à une montagne mais à une arête, à une face, à une paroi. Ce qui compte c'est la difficulté.
1887 Grand Dru et Petit Dru (traversée)
Les alpinistes François Simond, Émile Rey et H. Dunod franchissent le dangereux passage rocheux qui sépare le Grand Dru du Petit Dru. Assurés par des cordes maintenues en hauteurs par leurs compagnons, les trois hommes entament la descente et la traversée verglacée par le versant nord.
Les sans guide
A la suite de Mummery, des cordées de sans guides apparaissent, l'alpinisme devient un sport populaire en Bavière, e, Autriche et en Suisse...
Jusque-là, pour atteindre leurs buts, il semblait légitime aux cordées souvent anglaises de recourir aux services de solides montagnards qui assuraient les risques principaux de l’entreprise… Désormais rien ne doit venir s’interposer entre l’ascensionniste et la montagne… Le but ultime du jeu est de devenir autonome et responsable…
1901 arête du Brouillard et arête de l'innominata
Les frères Gugliermina inaugurent l'arête du Brouillard et reprennent l'arête de l'Innominata en 1921.
Ravanel le rouge
Outre Émile Fontaine, Joseph Ravanel conduit en montagne entre autres Albert Ier de Belgique, le peintre Edgard Bouillette et le photographe Gaston Liégeard.Deux cordées exceptionnelles
Gravir les cimes des Alpes par des faces d’une seule envolée et par des arêtes vertigineuses, ce sera la plus belle période de l’alpinisme de1875 et jusqu’en 1914…Après le temps de Mummery, deux cordées exceptionnelles vont venir marquer à jamais notre histoire…
-
De 1904 à 1914, Valentine J. E. Ryan va former avec ses guides Franz Lochmatter et ses frères, une équipe parfaite et efficace. L’arête est de l’Aiguille du Plan, la Dent d’Hérens par l’arête est et surtout la face Sud du Täschorn sont les ascensions les plus marquantes d’une série exceptionnelle de grandes ascensions…
-
L'arête est de l’aiguille du Plan appelée aujourd'hui arête Ryan est un bel exemple de passages d'escalade en fissures du quatrième degré limite supérieure de nos cotations techniques actuels. Une escalade réalisée sans piton et en chaussures à clous…
-
Durant cette même période, la cordée constituée de Geoffrey Winthrop Young et de son guide Joseph Knubel réussira d’une série équivalente de grandes ascensions dont la face est de l’aiguille du Grépon avec sa fameuse fissure Knubel (réussie en chaussure à clous et avec un coincement de piolet, reprise un peu plus tard en escalade plus orthodoxe par Franz Lochmatter) et l’arête du Brouillard au Mont Blanc.
Un exploit unique
Les deux équipes Ryan-Lochmatter et Young-Knubel partageront certains exploits notamment la face Sud du Täschorn.
- En 1906, les deux cordées sont engagées sans piton dans le versant sud du Täschorn dans les Alpes valaisannes pour un exploit historique. Ayant atteint un point de non retour, les deux cordées se réunissent et Franz Lochmatter force le grand dièdre terminal qui présente des difficultés du cinquième degré limite supérieure de nos cotations techniques actuelles. Il faudra attendre trente années pour voir d'autres grimpeurs reprendre l’itinéraire réussi par le génial guide de Zermatt. C'est un exploit unique, obligé par les événements…
Autant Ryan était peu communicatif, autant Young a su nous laisser une œuvre littéraire de grande qualité. Mes aventures alpines et Nouvelles ascensions dans les Alpes sont deux ouvrages incontournables de la littérature alpine.
L'école de Munich
-
En l’année 1910 est réuni à Munich, au sein du Club alpin bavarois, un groupe de grimpeurs exceptionnels, comprenant entre autres Paul Preuss, Hans Dulfer, Otto Herzog, avec un peu plus à l'écart dans ses montagnes Hans Fiechtl, que l'on appellera l'école de Munich.
-
Ce groupe va par ses performances, par ses perfectionnements techniques et par ses idées novatrices, profondément faire évoluer l'escalade ... Tout va aller très vite...
Et Munich va remplacer pour un temps Londres comme centre de référence pour tout ce qui concerne l’alpinisme…
Un exploit inouï
En 1911, Paul Preuss, à la recherche de la perfection, réussit l'ascension de la face est du Campanile Basso, dans les Dolomites occidentales, seul, sans piton, sans corde et redescend par le même itinéraire sans l'aide de la corde. Cette paroi est équipée aujourd'hui de plusieurs pitons et réclame beaucoup d’attention aux grimpeurs d’aujourd’hui... L'escalade courte et exposée, haute de 120 m, présente des passages du cinquième degré de difficulté. Contrairement à l'exploit contraint de Lochmatter, ici c'est en toute liberté d'action et de décision que l'on escalade et désescalade une paroi du cinquième degré de difficulté…
- En cette année 1911, paraît dans la revue Deutscher Alpenzeitung, sous la plume de Paul Preuss, l'article clef concernant les moyens de l'escalade. C'est le début de l'immense polémique sur l'utilisation de moyens artificiels en escalade « de même que l'alpinisme diffère de l'art de grimper ... la solution d'un problème d'escalade peut être du point de vue de l'alpinisme dépourvue d'intérêt... le respect du style, qu'il s'agisse d'alpinisme ou d'escalade pure, devrait être la règle formelle pour chaque grimpeur ».
- Le piton, la corde, la descente à la corde, rien ne résiste pas à la critique de Preuss, c'est le rejet de tout moyen artificiel. Mais le prophète ne pourra être suivi car l'exigence était trop élevée ...
L'escalade artificielle
En 1911, Hans Fiechtl, l'inventeur du piton moderne, est le premier à les utiliser comme moyen de progression. Avec H. Hotter, il gravit l'arête est-nord-est du Feldkopf sur la Zigmondyspitze, dans les Alpes orientales, des passages présentent des difficultés importantes d'escalade artificielle (A2). Particulièrement critiqué pour son emploi systématique des pitons de progression - la crucifixion des parois - il est traité par le Trentin Tita Piaz, l'un des artisans de la polémique sur les moyens de l'escalade, de « gangster du rocher, de jongleur des passages défendus».
- En 1911 avec l’emploi des pitons, Angelo Dibona le guide de Cortina réussi l’ascension de la paroi nord de la Laliderwand dans le Karwendelgebirge.
- En 1912, en appliquant les nouvelles techniques de traversées à la corde, d'assurage et de progression avec l'aide des pitons, dans une grande paroi, Hans Dulfer réussit avec un compagnon l'ascension du versant est de la Fleichbank et la face ouest du Totenkirchl dans le Kaisergebirge. Plus rien n’arrêtera les grimpeurs…
- Cette même année Angelo Dibona et ses compagnons réussissent l'ascension de la face sud de la Meije, dans le massif des Écrins. Dibona apporte dans les Alpes occidentales le savoir-faire des Alpes orientales.
Le refus des britanniques
Les Britanniques, au sein de l'Alpine Club, prennent position contre l'utilisation des moyens artificiels et des pitons. Ils vont rester longtemps à l'écart de la « conquête » des grandes parois rocheuses des Alpes avec pitons, et ne réapparaîtront dans les Alpes que cinquante années plus tard en ayant beaucoup évolués concernant l’emploi des pitons, jusqu'à trouver une solution plus satisfaisante avec les coinceurs, d’abord des boulons dès 1960, puis des outils plus élaborés dès 1970…
Les deux façons de faire
C'est en 1914 qu'il faut situer l'origine de deux pratiques antagonistes de l’escalade : les adeptes de l'escalade sportive et ceux pour qui l'escalade est une simple moyen de l’alpinisme.
- L'escalade sportive est surtout pratiquée sur les falaises des Iles Britanniques et en Allemagne de l'Est avec des règles précises, on doit grimper sans aucune aide extérieure et réaliser l'assurage par des moyens naturels, refus de l'utilisation des pitons comme moyen de progression, d'aide ou de repos bien sûr, mais également comme moyen d'assurage. L'assurage naturel qui utilise les reliefs de la roche - béquet, prise ou anneau naturel de la roche, etc.- sera uniquement réalisé à l'aide d'anneaux de cordes, de nœuds et pierres coincés dans les fissures de la roche et beaucoup plus tard par l'utilisation des coinceurs métalliques. Les pratiquants de cette discipline sportive ne chercheront curieusement pas à exporter cette façon de faire en haute montagne et on laissera bien seul Paul Preuss prêcher la bonne parole.
- Chez les grimpeurs des pays alpins, l’escalade est un simple moyen de l’alpinisme, cette pratique va rester longtemps influencée par l'école germanique née dans les Alpes Orientales. La rigueur du geste sportif pèse faiblement devant l'engagement moral et le dépassement physique. En une phrase : la fin justifie les moyens. La fin étant le sommet, le mythe de la paroi impossible ou encore l'affrontement des incertitudes de la montagne…
Le Groupe de Haute Montagne
En l’année 1919, naissance d’un alpinisme français organisé…
Au lendemain de la guerre, "issus d’un petit groupe de grimpeurs formé à la veille de la guerre qui en a retardé l’essor" Jacques de Lépiney et Paul Chevalier fondent le Groupe de Haute Montagne, pour un temps section de Club Alpin Français…
Leurs entreprises alpines, un peu plus tard renforcées par celles des Jacques Lagarde, Henry de Ségogne et autres, vont les conduire en peu de temps au même niveau de performance que nos voisins austro-allemands, suisses et italiens…
Les derniers problèmes, la conquête des faces Nord
Développement de l'alpinisme sans guide et de la technique. Un nouveau pas en avant grâce à l'emploi de moyens nouveaux. Les crampons, connus depuis longtemps, mais dont l'usage est généralisé, vont permettre de franchir plus rapidement et plus facilement les pentes de glace. L'invention des pitons donnent une "assurance" plus grande au grimpeur de tête.
1925 Aiguille du diable, pointe isolée
1928 Aiguille verte, le Nant Blanc
Le dernier grand problème des Alpes est résolu.
La période des grandes expéditions nationales

1950 Annapurna (8091 m)
victoire à l annapurna.pdf
1952 Fitz Roy (Patagonie)
Première ascension réalisée par Lionel Terray et Guido Magnone.
1953 Everest (8848 m)
1954 Aconcagua (6959m)
L'exploit de forcer, en sept jours et en technique alpine, au-dessus d'un camp 2, un itinéraire dans la formidable face sud de la plus haute montagne du continent américain.
Sommet le 25 février 1954 pour Lucien Bérardini, Adrien Dagory, Edmond Denis, Pierre Lesueur, Robert Paragot et Guy Poulet La plupart des équipiers auront à subir malheureusement de douloureuses amputations.1954 K2, deuxième hauteur mondiale (8611m)
1955 Makalu (8463m)
Meilleur préparation physique, entraînement des grimpeurs dans des écoles d'escalade, meilleur connaissance de la montagne, de ses dangers, de procédés de progression.
Le développement de l'emploi des procédés artificiels d'escalade permet de repousser les limites de l'impossible.
Walter Bonatti gravit le pilier après une épopée de cinq jours.Il accomplira par la suite des premières hivernales, notamment dans les Grandes Jorasses et au Cervin. En 1961, sa passion sera ternie par une tragédie, au Frêney, où il perdra quatre de ses compagnons. Il mettra un terme à sa carrière en 1965.

Au milieu des années 1960, Claudio Barbier développe l'escalade libre en Belgique: il propose de peindre en jaune les pitons que le grimpeur ne devrait pas utiliser comme prises. Idée qui, dans un premier temps, va susciter une certaine polémique au sein du Club Alpin Belge, mais qui va connaître un succès considérable dans les milieux européens de l'escalade. Désormais, lorsqu'il s'agira d'escalade libre réalisée sans l'aide des pitons de progression en tant que prises, on parlera de "jaunir" une voie.
En 1969, il crée le G.B.A. (Groupement Belge d'Alpinistes) dont il souhaite faire l'équivalent belge du réputé G.H.M. (Groupe de Haute Montagne) français.
Claudio a parcouru plus de 650 voies de montagne, dont au moins 161 ascensions en solo.
L’Italien Reinhold Messner atteint le sommet de l’Himalaya seul, sans oxygène supplémentaire et sans aucun contact radio. Avant l’exploit, ce miraculé chute dans une crevasse mais s’en sort indemne. Après quelques clichés photographiques, il redescend à bout de force, un rêve réalisé. Il sera, par la suite, le premier à gravir les quatorze sommets de plus de 8 000 m. du monde (1986). Il sera également le premier à relever le défi des « seven summits » (atteindre le point culminant de chacun des sept continents).
2005 Grandes Jorasses, voie Heidi (face nord)
ouverture par Patrick Gabarrou, Christophe Dumarest, Philippe Batoux
2008 record ascension Eiger (face nord)
par Ueli Steck en un temps record 2h 47 mn
2008 record ascension Grandes Jorasses, face nord voie Colton-McIntyre (à vue)
par Ueli Steck en un temps record 2h 21 mn
2009 record ascension Cervin, face nord voie schmidt (à vue)
par Ueli Steck en un temps record 1h 56 mn
2011 ouverture au Mattherorn (Cervin), Mont Blanc et Mont Rose
Hervé Barmasse ouvre trois nouvelles voies:
- Au Cervin en solo
- Au Mont Blanc avec les frères Pou. La voie baptisée "La classica Moderna" parcours le versant Freney du Mt Blanc et a été réalisée en libre en total autonomie. (cotation 6c).
- Au Mont Rose avec son père, la voie longue de 800m est côtée ED.
2013 Face sud de l'Annapurna
Uesli Steck en solo et en 28 heures
Hervé Barmasse | Exploring the Alps # 1 | Solo on Matterhorn from STORY.teller on Vimeo.
Ouverture au Mont-Blanc par Hervé Barmasse et les frères Pou
Exploring the Alps # 4 | New route on Mont Blanc from STORY.teller on Vimeo.
Exploring the Alps #5 | New route on Monte Rosa from STORY.teller on Vimeo.